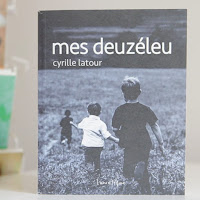Critique du Prix littéraire des Grandes Écoles
Critique parue sur le site du Prix littéraire des Grandes Écoles
(De l'univers visible et invisible faisait partie de la présélection)
Que croire ? La réalité objective ou
l’intimité subjective ? Question classique que semble poser l’œuvre de
Cyrille Latour. La réunion de ces deux cercles, de ces deux mondes au
sein d’une énergie nouvelle qui serait l’expérience de la « vraie
sensation » dont parle M. Edouard est un thème privilégié de tout temps
par les romanciers.
Comment opérer la réconciliation? La
structure en parties, cadre du roman, un cadre qui d’ailleurs est
l’objet qui figure sur la première de couverture illustre bien la marche
vers ce qui va se révéler être une aporie. Comme si l’œuvre, elle-même
photographie désespérée, tentait de saisir des antagonistes et rendre
présents les absents, elle présente les deux parties en présence et
tente la réconciliation en troisième lieu : « En présence des absents ».
Il faut croire et y croire : la Gospa vient pour la réconciliation,
ceux qui croient en l’apparition sont le point d’horizon qui fait se
rejoindre les deux univers. Ce Credo en un « Seigneur de l’univers
visible et invisible » se retrouve dans l’action de la littérature.
N’est ce pas le but d’un roman, de réconcilier l’univers visible et
invisible ? Souvent définie comme le récit de la confrontation entre
réalité et idéaux, l’œuvre romanesque se conclut généralement par un
échec de ces derniers: la guerre est là.
Mais alors on se reprend : le titre n’est
pas « Des univers visible et invisible ». Il n’y a qu’un seul univers
dans lequel la présence et l’absence s’entremêlent amoureusement.
Mais alors le roman dépasse son schéma
apparemment très simple et les quelques maladresses d’écriture, va
au-delà, et procure cette sensation d’un voyage intérieur, d’une
réflexion, à laquelle on reconnaît une création. L’opposition n’est pas
établie entre les absents et les présents, ce n’est pas le sujet qu’il
veut traiter. Au contraire, tout le travail de narration consiste à
aller chercher la présence propre des absents, cette présence spécifique
que l’on sent sans saisir.
Mais alors, la vraie réconciliation est
là, dans les mots, dans les lettres, dans ces deux écritures
épistolaires qui closent chacune une partie du roman : la lettre d’un
fils lue par le narrateur « ils disent que le village est épargné par la
guerre, je ne sais pas trop s’ils y croient eux-mêmes, mais c’est ce
qu’ils disent…ils sont persuadés d’être protégés par la Vierge », la
lettre d’un père lue par Béatrice.
Mais alors les absents sont là, en présence. On émerge de ce roman en acceptant les nôtres.
La paix est faite.
FT